
Nous vivons un moment exceptionnel dans la vie intellectuelle et éditoriale. Tous les sujets naguère interdits ou tabous ne le sont plus. Tout ce qui était ostracisé, sulfureux, « réactionnaire », « fasciste » est mis sur la table, ou plutôt sur papier. Immigration, islam, racisme anti-Blanc, féminisme, lobbys ethniques et sexuels, tout est déconstruit et mis en accusation.
Des journalistes de « gôche », des maisons d’édition les mieux-pensantes s’y mettent avec l’enthousiasme des convertis.

C’était l’introduction d’un article d’Eric Zemmour paru dans Le Figaro Premium,
article dont voici la suite :
Les uns sont sincèrement convaincus, les autres veulent seulement vendre des livres. On pourrait croire qu’ils auraient l’humilité des derniers arrivés et rendraient hommage à ceux qui les ont précédés, subissant insultes, menaces, voire sanctions judiciaires et interdits professionnels. Ce serait trop leur demander ! Ils ont gardé de leur ancienne vie la morgue de ceux qui sont dans le vrai ; ils continuent de faire la leçon, même si leur leçon est à l’inverse de leurs anciens discours ; et osent poursuivre de leurs sarcasmes, les traitant de caricatures, idéologues, pamphlétaires, polémistes, ceux qui avaient pourtant vu ce qu’ils voient, mais des années avant eux. Ils pratiquent cette « ingratitude » que l’on attribue aux Grands, sans doute par besoin de se grandir.

Isabelle Barbéris
Ainsi, Isabelle Barberis, spécialiste du théâtre contemporain et maître de conférences à l’université Paris-Diderot, s’en prend-elle à l’art contemporain, avec des arguments déjà lus sous la plume de Philippe Muray, Marc Fumaroli, et bien d’autres. Elle le fait dans un jargon épouvantable, abscons et prétentieux, qui nécessite de relire plusieurs fois la même phrase pour en saisir le sens. Un exemple au hasard :
La mode des fictions théoriques et du réalisme spéculatif repose sur une confiance à certains égards illimitée et excessive dans la qualité performative de l’imagination, revenant sur des siècles de distinction entre praxis et poïesis, phénomène que Françoise Lavocat qualifie de “panfictionnalisme” – équation du réel et de la fiction que pour ma part j’aborde plus volontiers comme un “panréalisme”.
Respirez et relisez plusieurs fois. Vous finirez par comprendre! Vous finirez surtout par comprendre que notre universitaire utilise le vocabulaire de son milieu pour mieux dénoncer ses travers. C’est à la fois courageux et limité. Elle dénonce l’entre-soi avec les mots de l’entre-soi. Elle ne peut – et ne veut ? – être lue que par les siens.
Ceux qui ont eu la chance de voir le film The Square (qui a reçu la palme d’or au Festival de Cannes 2017) ont déjà saisi l’essentiel de l’ouvrage de notre universitaire, à savoir l’art contemporain saisi par le démon du politiquement correct:
- obsession de « l’inclusion » des prétendus « invisibles » ;
- antiracisme qui tourne au racisme anti-Blanc ;
- procès permanent des oeuvres du passé au nom de l’idéologie d’aujourd’hui (sexisme, racisme, homophobie) ;
- utilisation des méthodes publicitaires au service du progressisme.
Notre universitaire y ajoute dans la version française une dénonciation du colbertisme culturel qui, depuis Jack Lang, s’est mis au service de ce militantisme politiquement correct :
Tout projet ne fournissant pas la démonstration (en langage administratif) de son haut dosage subversif s’expose au risque de ne pas exister. […] Les fachos arrivent, c’est le ministère de la Culture qui vous le dit. Fort heureusement, l’ambroisie de la subvention absout tout fascisme, c’est bien connu.

Le dernier ouvrage
d’Isabelle Barbéris
Isabelle Barberis donne des exemples connus (la fin de Carmen inversée pour que la femme tue l’homme) et d’autres qui le sont moins (une pièce ambiguë à la gloire de Mohamed Merah) ; elle pointe du doigt le Festival d’Avignon de l’an dernier « emblématique du tournant identitaire des arts à l’intérieur du service public culturel, dernière étape d’une démocratisation culturelle exsangue ». Elle dénonce la puissance des lobbys féministes, LGBT et antiraciste ; leur mégalomanie (le président du Cran qui se fait appeler « son excellence le premier ministre de la diaspora africaine mondiale »), leur mauvaise foi, leur racisme, leurs parrains étrangers (Rokhaya Diallo invitée par la Fondation Obama), et plus généralement cette contre-culture américaine qui nous impose son imaginaire et ses obsessions: « Nous faisons nôtre un rétablissement du réel ethnique et biologique d’où ressurgissent des mythes dont on pensait avoir eu raison, et que l’on croyait précisément avoir déconstruits : le bon sauvage, le culte des ancêtres, la “régénération” par la culture allogène […] »
Isabelle Barberis a bien compris la mécanique de nos nouveaux maîtres, le mélange des idéologies marxiste et identitaire, qui sont comme le nitrate et la glycérine, permettant le dynamitage des « Blancs » au nom de la lutte contre le capitalisme et de la France au nom de l’antiracisme. Une colonisation culturelle qui se fait au nom de l’anticolonialisme.
Notre universitaire n’ose pas encore le mot de décadence, sans doute pour éviter de passer pour une décliniste caricaturale, mais elle y vient :
La déglutition par les classes populaires d’images ultra-violentes dans les salles suréquipées qui bombardent le spectateur de stimuli de plus en plus agressifs est symétrique à la consommation par l’élite d’une culture de la pure négativité. L’un entretient l’autre. Jamais l’imaginaire n’aura produit autant de laideur de toute l’histoire de l’humanité.
Les dernières pages du livre sont étonnamment écrites dans une langue débarrassée de jargon et de néologismes de cultureux. Elle cite Victor Hugo :
« À force d’être une âme, on cesse d’être un homme»
pour se moquer du moralisme de nos bien-pensants. Elle a raison : au moins le grand Hugo écrivait en français. Il constitue une base idéale pour réapprendre à penser et rédiger dans une belle langue. Isabelle Barberis est en convalescence après une grave maladie. On lui souhaite un bon rétablissement.
Eric Zemmour pour Le Figaro Premium.


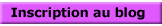

Suivre @ChrisBalboa78
