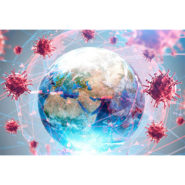
Voici la suite des extraits du livre-choc du professeur Christian Perronne, publiés dans le dernier Figaro Magazine :
Etonnante inertie
Dès le 5 septembre 2016, Jérôme Salomon disait au candidat Macron que les hôpitaux auraient le plus grand mal à gérer un afflux de victimes important. Devenu, Président, celui-ci n’aurait-il pas pu redresser la barre ? Equiper les soignants ? Faire un diagnostic précis des stocks disponibles ? S’il avait été sourd aux recommandations de son directeur général de la Santé, n’avait-il pas entendu parler des onze mois de manifestations du personnel hospitalier ? […] Oui, le président de la République savait que les hôpitaux français n’étaient pas armés pour faire face à un afflux de patients. Mais quelles conclusions en a-t-il tirées ? Je le dis ici : devant la férocité du virus qui nous est tombé dessus, devant sa fulgurance à infecter le monde entier, je pose une seconde ma blouse d’infectiologue et j’avoue que je ne sais pas ce que j’aurais fait à la place du gouvernement. Aurais-je pris toutes les bonnes décisions ? Par prudence, je préfère dire que je n’en sais rien. Mais ce que je sais en revanche, c’est ce que j’aurais fait face à l’épidémie, et devant le constat des pénuries généralisées, j’aurais activé en urgence procédures et marchés pour effectuer des commandes de tout, dans tous les sens. Et j’aurais réfléchi après, avec mes collègues et les responsables de l’administration, pour construire le plan de bataille. Et ce que je sais surtout, c’est que je n’aurais pas menti aux Français. Six cents médecins ont saisi la justice pour « mensonge d’Etat ». Nous verrons alors si Cicéron avait raison : « Celui qui a l’habitude du mensonge a aussi celle du parjure. » […] Pendant ma quinzaine d’années de collaboration étroite avec le ministère de la Santé pour la gestion des maladies infectieuses, j’ai vu un changement grave s’opérer lors de la transformation du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) en Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Avant, il y avait des dizaines de médecins de santé publique, qui travaillaient au sein de la Direction générale de la santé (DGS). Ces médecins connaissaient tous les acteurs de terrain en France. Sur le long terme, pour la gestion à froid de certaines infections, mais surtout en cas de crise, ces médecins pouvaient se répartir la tâche et former, chacun en un clin d’oeil, un groupe d’experts avec qui ils avaient, donc, l’habitude de travailler. Ils pouvaient en un temps record analyser les données scientifiques nationales et internationales et produire des rapports très précis pour le CSHPF, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France. Le CSHPF pouvait alors faire une synthèse en urgence pour le directeur général de la Santé et le ministre. Ce bouillonnement d’experts et cette interaction directe avec les décideurs étaient redoutablement efficaces. Mais pourquoi maintenir une structure qui marche bien ? Les énarques seraient au chômage technique si on ne les laissait pas réinventer l’eau tiède et tout changer. De « grands » conseillers ont jugé que cette collusion entre experts et décideurs était inacceptable et qu’ils ne devaient plus se fréquenter. On a ainsi transformé le CSHPF en HCSP. Le Conseil a été viré du ministère de la Santé. Les liens avec la DGS ont été rompus. Surtout on en a profité, économies obligent, pour ne laisser qu’un seul médecin de santé publique pour tout gérer, la routine plus les crises sanitaires. J’avais dénoncé à maintes reprises cette nouvelle organisation censée être plus « indépendante et efficiente ». Mais on ne m’a pas écouté. C’est pour cette raison qu’en février 2016 j’ai refusé de prolonger mon mandat de président de la commission Maladies transmissibles du HCSP. On s’aperçoit aujourd’hui, dans une situation de crise majeure, que cette réorganisation a été catastrophique. […] Dans la crise du coronavirus, le résultat serait comique si la situation n’était pas dramatique. Le président du HCSP, Franck Chauvin, professeur de santé publique et membre du Conseil scientifique Covid-19, signe l’avis. Et dans l’avis, qu’est-ce qui est écrit ? Qu’il faut réserver l’hydroxychloroquine aux formes graves de la maladie. Devant le tollé suscité par ce texte chez les médecins et dans la population, le Pr Chauvin déclare quelques jours plus tard au Canard enchaîné qu’il reconnaît que cet avis est absurde, mais qu’il a subi des pressions pour le signer. Des pressions ? Lesquelles ? De qui ? On aurait aimé en savoir plus !
Dès qu’il y a une épidémie, c’est panique au ministère
Zoomons encore un peu plus, pour parler de l’infectiologie en France, là aussi laminée par l’Etat. Avant l’épidémie de sida, les services de maladies infectieuses et tropicales étaient rares et les autorités voulaient les fermer, car des énarques et des intellectuels de la santé publique, conseillers de nos gouvernants, disaient que les maladies infectieuses allaient disparaître grâce à l’hygiène, aux vaccins et aux antibiotiques. Puis il y a eu, patatras, la pandémie de VIH. Et depuis les épidémies se sont succédé, notamment l’épidémie d’hépatite C. Mais pour les autorités et pour les crédits de recherche, l’infectiologie vue par les « hautes sphères » était limitée au sida et aux hépatites virales. […] Ce qui est surprenant, c’est que ce soit l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), longtemps dirigée par le Pr Jean-François Delfraissy, qui soit chargée par le ministère et l’Inserm de piloter tous les sujets d’infectiologie qui ne sont pas, a priori, de son ressort. Ainsi le Pr Delfraissy se trouve-t-il parachuté président du Conseil scientifique officiel Covid-19. […] Dès qu’il y a une épidémie, c’est panique au ministère, les microbes font très peur aux ministres, car un microbe en phase épidémique est souvent imprévisible. Mais dès que l’épidémie est passée, on oublie tout et le nouvel énarque du nouveau cabinet ministériel va repartir dans le trip « les maladies infectieuses, on n’en a pas besoin ». Et on rabote à nouveau les moyens. Je me suis égosillé pendant des années à expliquer aux différents interlocuteurs du ministère que les maladies infectieuses étaient imprévisibles. Que, de fait, il fallait planifier sur le long terme une activité à géométrie variable, en fonction du contexte. En période normale, je le dis, la taille des services peut être réduite. Mais il faut, en ce cas, prévoir l’ouverture de chambres d’hospitalisation supplémentaires en cas de crise. Qui dit chambres dit aussi personnel soignant capable d’y accueillir des malades supplémentaires, évidemment ! […] Le vaccin grippal, c’est comme le beaujolais nouveau, il est différent chaque année afin de suivre l’évolution des virus mutés qui circulent. Ainsi les années où des mutants outsiders du virus circulent, ils n’étaient pas prévus dans la composition du vaccin grippal qui vient de sortir ! Il en résulte une baisse d’efficacité du vaccin responsable d’une vague épidémique beaucoup plus élevée. Ces années-là, on ne sait plus où caser les malades qui contaminent beaucoup de personnes dans les hôpitaux. J’ai piloté, avec l’aide de quelques collègues, un lobbying actif auprès de nombreux cabinets ministériels pour qu’en France l’infectiologie soit reconnue comme une spécialité à part entière. Il a fallu dix ans de combat acharné pour obtenir gain de cause.
Le médecin de moins en moins considéré …
Des experts canadiens ont lancé il y a longtemps le concept de « médecine factuelle » aussi appelée « médecine basée sur les preuves » ( « evidence based medecine »). Pour un médecin, la décision thérapeutique doit reposer sur trois éléments. Tout d’abord l’évidence scientifique des publications. Si les données publiées sont solides, cet élément de décision est primordial. Malheureusement, il existe de nombreuses situations en médecine où les données publiées sont inexistantes ou de mauvaise qualité. Dans ce cas, cet élément de décision perd beaucoup de son intérêt. Le deuxième élément, c’est l’expérience du médecin, toujours importante et qui, en situation de faiblesse des données scientifiques publiées, devient primordiale. Il faut toujours tenir compte des témoignages des médecins et de leurs retours d’expérience. Enfin le troisième élément, sur lequel se fonde la décision médicale, est le choix du malade. Un médecin digne de ce nom, respectant le serment d’Hippocrate, doit expliquer à son patient les forces ou faiblesses des publications scientifiques, lui parler de son expérience et de celle de ses confrères. Ensuite, il doit lui exposer, avec rigueur et honnêteté, les différentes solutions proposées. En dernier ressort, c’est au malade de décider quel traitement il va prendre. Dans l’art d’exercice de la médecine, l’éthique, la déontologie, est cruciale. Quand je suis face à un patient et que le choix de la prise en charge est délicat, je me dis toujours: « Et si c’était pour moi ou ma famille, que ferais-je ? » Cela m’a toujours guidé. La loi Bertrand, par exemple, veut empêcher les médecins de prescrire les médicaments en dehors des AMM (autorisation de mise sur le marché). C’est une atteinte directe à la liberté de prescription des médecins, pourtant inscrite dans le code de déontologie. Or, dans la pratique de tous les jours, surtout à l’hôpital, la prescription hors AMM est très fréquente et peut atteindre 80 % à 100 % des prescriptions dans certains domaines. Autre illustration des demandes folles faites aux médecins aujourd’hui, concernant l’éthique : le 19 mars dernier, Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à l’université Paris-Saclay, écrit dans une lettre, publiée dans Mediapart : « La hiérarchisation des choix doit être faite selon des protocoles. Cela permet de neutraliser la responsabilité: le soignant a ainsi moins le sentiment d’assumer personnellement une décision à impact vital. » Phrase écrite en pleine crise de coronavirus, je le rappelle. Avec des collègues, nous décidons de lui répondre […] que nous voulons « assumer notre responsabilité de traiter chaque malade qui nous accorde sa confiance au mieux des connaissances médicales les plus récentes ». Nous avons ajouté qu’« aucun médecin ne peut accepter de traiter un patient qui lui accorde sa confiance selon des normes étrangères à sa seule conscience. De même, il n’est pas possible de nous interdire l’utilisation de médicaments potentiellement efficaces dans un contexte d’urgence absolue ». La lettre s’achève en lui disant, enfm, qu’à nos yeux « la responsabilité médicale est assurée par le médecin, elle ne se délègue pas ». Le professeur Christian Perronne dans son livre :
« Y a-t-il une erreur qu’ILS n’ont pas commise ? »
Le Figaro Magazine.
Voici une nouvelle interview du professeur Perronne par Jean-Marc Morandini dans laquelle il accuse l’hôpital de Nantes d’avoir laissé mourir son beau-frère ;
Témoignage très émouvant du professeur Perronne ce matin sur @CNEWS chez @morandiniblog : J’ai perdu mon beau frère car les médecins de Nantes n’ont pas voulu lui administrer le traitement @raoult_didier pic.twitter.com/UR5qLmHhw9
— Mouâd Boutaour Kandil (@boutaour) June 18, 2020


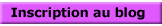

Suivre @ChrisBalboa78
