
« L’autoritarisme met en danger l’autorité. »
« Le monarque républicain n’est pas celui qui dissout sa fonction dans son moi, c’est celui qui dissout son moi dans sa fonction. »
Les deux aphorismes précédents sont d’Henri Guaino, l’ancien conseiller (et plume) de Nicolas Sarkozy.
Ils sonnent comme une condamnation sans appel de la pratique présidentielle d’Emmanuel Macron !
Je rapproche souvent Henri Guaino de Philippe Séguin. Tous les deux de grands talents mais à qui il semble manquer un petit quelque chose pour avoir un destin national. A moins que tous les deux aient quelque chose en trop : un caractère trop bien trempé et trop intransigeant sur les principes …
Je relaye ici la longue interview qu’a donné Henri Guaino au magazine Le Point. On manque beaucoup d’hommes (ou de femmes !) de la trempe d’Henri Guaino, qui n’aient pas perdu de vue l’essence de la V ème République.

Les samedis se suivent et se ressemblent avec des images désormais familières : des manifestations pacifiques qui dégénèrent, des forces de l’ordre débordées, des magasins saccagés et du mobilier urbain dégradé. L’autorité de l’État est-elle atteinte ?
C’est ce que semble penser Henri Guaino. L’ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, ex-député et commissaire général au Plan entre 1995 et 1998 tire la sonnette d’alarme et met en garde contre l’affaiblissement de l’État, notamment en cette période de crise sanitaire, économique et sociale. Tout en expliquant qu’il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. Henri Guaino est l’invité du grand entretien du Point.
« L’autoritarisme met en danger l’autorité de l’État »
L’ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy tire la sonnette d’alarme sur un État qui, selon lui, n’est plus respecté.
Le Point : Manifestations violentes, défiance d’une partie de la population, gronde des collectivités locales… Que vous inspire la crise que semble traverser l’État ?
Henri Guaino : Il y a de quoi s’alarmer. Sur fond de crise générale de l’autorité, de toutes les autorités, et de montée de la violence, l’effondrement de l’autorité de l’État serait catastrophique : il ferait tomber l’ultime rempart contre le chaos et la sauvagerie qui menacent nos sociétés. On en est, hélas, pas loin.
Le Point : L’autorité de l’État est, certes, contestée, mais n’est-il pas exagéré de parler d’un risque d’effondrement ?
Henri Guaino : Il faut tordre le cou à l’idée que tous les désastres auxquels l’humanité a été confrontée dans le passé ne peuvent plus se reproduire. Après la chute du mur de Berlin, une bonne partie de l’intelligentsia occidentale s’était ralliée à la théorie de la fin de l’histoire par le triomphe planétaire et définitif de la démocratie et du marché. La majorité des élites occidentales en a fait une religion sur laquelle a été bâti le monde d’aujourd’hui. Et quand on regarde l’état du monde actuel, on voit à quel point c’était une idée folle. On a eu la crise financière de 2008 qui ne pouvait plus se reproduire et nous nous sommes arrêtés in extremis au bord du gouffre, on a eu le terrorisme qui ne pouvait pas revenir, on a eu l’explosion de violence des Gilets jaunes qui était impensable, on a eu un type de pandémie, dont les pays les plus développés avaient fini par se croire définitivement à l’abri. Cela ne pouvait plus nous arriver, donc, nous n’y étions pas préparés. Si nous continuons à croire que ce qui est arrivé à toutes les sociétés humaines ne peut plus se produire, nous le payerons très cher. Et ce qui arrive à toutes les sociétés humaines, c’est que lorsque leur malaise est trop grand, leurs divisions trop profondes, elles cherchent instinctivement à reconstituer leur unité dans la violence. C’est l’histoire du bouc émissaire du malheur, de la persécution unanime, de la violence mimétique si bien décrite par René Girard et dont le XX ème siècle nous a confirmé qu’elle n’était pas l’apanage des sociétés primitives.
Le Point : Pourtant, beaucoup se plaignent d’un État trop autoritaire, la France a été rappelée à l’ordre par la haut-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU…
Henri Guaino : Le remède n’est pas dans l’autoritarisme. C’est une dangereuse illusion de croire que l’autorité se décrète. L’autorité, ce n’est pas quelque chose que l’on impose, c’est quelque chose qui s’impose, c’est la légitimité du commandement reconnue à celui qui l’exerce par ceux sur lesquels elle s’exerce. L’autorité véritable, ce n’est pas celle du chef selon les généraux qui en 1916 envoyaient les poilus à l’abattoir pour rien jusqu’à provoquer les mutineries qui ont bien failli nous faire perdre la guerre. La vraie autorité, c’est celle du chef, selon Lyautey, ou selon de Gaulle dans Le Fil de l’épée. Ou selon le lieutenant Tom Morel, chef du maquis des Glières : « Pour être chef, il faut avoir du prestige, et ce prestige, il faut l’acquérir par la générosité, de l’entraide mutuelle, du dévouement. »
L’autoritarisme met en danger l’autorité.
On le sent très bien quand on en touche les limites comme dans la gestion de la crise sanitaire. Quand on dit que l’État dispose de la violence légitime, le mot important, c’est « légitime ». C’est fragile, la légitimité. La maintenir, c’est tout l’art de gouverner.
Mais l’autorité de l’État, qu’en reste-t-il quand chaque manifestation est désormais marquée par la violence contre les policiers et des dégradations contre des magasins, des voitures ou du mobilier urbain…
La grande question est de savoir si l’État contribue à guérir ou à aggraver la crise de l’autorité, et à canaliser la violence ou à la nourrir.
Une règle d’or devrait être de ne jamais utiliser la police et la gendarmerie pour résoudre des problèmes politiques et sociaux en pratiquant la stratégie du pourrissement. Un tel usage de la force publique affaiblit l’autorité du commandement sur les forces de l’ordre et celle de la police sur les citoyens. Or depuis des années, on en abuse de plus en plus. C’est une situation d’autant plus dangereuse pour l’autorité de l’État et l’ordre social que les voyous et les casseurs ultraviolents tirent eux leur épingle du jeu. On a tendance à les laisser faire pour, soi-disant, éviter un accident, et quand on les interpelle, les sanctions ne sont pas à la hauteur. Mais quand le voyou n’est pas interpellé ou qu’il s’en tire avec un rappel à la loi ou quelques semaines de prison avec sursis pour avoir pillé un magasin, brûlé une voiture ou tabassé quelqu’un tandis que celui qui sort de chez lui sans attestation prend une contravention de 135 euros, l’autorité de l’État en sort considérablement affaiblie.
Le Point : Le président de la République affaiblit-il l’autorité de l’État quand il dit à Brut : « Si ça vous fait plaisir, je peux vous dire : il y a des violences policières » ?
Henri Guaino : Hélas ! Quand on a des reproches à faire à des hommes et des femmes qui sont placés sous votre commandement et qui comptent 25 tués et plus de 10 000 blessées par an en mission, on leur parle à eux : quand, en 1968, le préfet Grimaud écrit la fameuse lettre où il dit que frapper un homme à terre, c’est se frapper soi-même, il l’adresse aux policiers, non aux manifestants. C’est le moindre respect que l’on doit à ceux que l’on commande.
Ensuite, il y a le fond. Les conditions des contrôles d’identité sont strictement encadrées par l’article 78 du Code pénal qui laisse peu de marges au bon plaisir des policiers. Cette remarque sur les contrôles au faciès fait planer sur tous les policiers une présomption de faute qui va compliquer leur travail déjà de plus en plus difficile et dangereux. L’appel à la dénonciation à travers une plateforme numérique me semble plus délétère encore. Les comportements délictueux des policiers peuvent faire l’objet d’une plainte, d’une saisine du procureur de la République ou du Défenseur des droits, mais le signalement d’un comportement fondé sur un critère aussi vague que celui du contrôle au faciès à travers une plateforme viendrait renforcer la pente malsaine de nos sociétés vers une délation généralisée encouragée par l’État, qui plus est, ici, contre l’un de ses principaux piliers institutionnels.
Cet épisode nous rappelle aussi que la communication tous azimuts et tout le temps nuit gravement à l’autorité de l’État. Entre la trop grande rareté de la parole et l’excessive prolixité, l’art de gouverner consiste aussi à trouver un équilibre dont on s’éloigne de plus en plus.
Le Point : La loi sécurité globale a été votée par l’Assemblée nationale – avec les voix de la droite. Reculer, n’est-ce pas également affaiblir l’autorité de l’État et aussi la démocratie parlementaire ?
Henri Guaino : Dans une démocratie parlementaire, on ne fait pas tout ce que l’on veut au seul motif que l’on a une majorité au Parlement. Quand on sent que quelque chose ne passe pas et peut dégénérer parce que l’on a sous-estimé la profondeur ou la nature des oppositions, on le remet sur le métier au lieu de miser sur le fait que les manifestants vont s’user contre les CRS. Que croyez-vous qu’en pensent les commerçants qui se trouvent sur le trajet des manifestations et les CRS qui toutes les semaines attendent l’arme au pied sous les cocktails Molotov ?

La manifestation du 5 décembre a dégénéré.
Ce qui abîme l’autorité de l’État, c’est de prendre le risque d’avoir à capituler en rase campagne parce que la stratégie du pourrissement a échoué et que la situation devient inextricable. Et quand on pense que l’intérêt du pays est vraiment en jeu, il reste la question de confiance posée au pays avec le référendum. Ce qui est chimérique, c’est la recherche à tout prix du consensus ou de l’adhésion de tous. Mais le consentement n’est pas l’adhésion. Je consens à respecter des lois que je n’approuve pas. Jusqu’à un certain point. L’art de gouverner, c’est aussi celui de chercher la limite à ne pas dépasser, au-delà de laquelle le consentement devient révolte. Et quand il y a beaucoup d’hommes révoltés, il n’est plus possible de gouverner. Camus dit que l’homme révolté est un homme qui dit « non » et qu’y a-t-il dans ce « non » ? Il y a « vous avez franchi une limite ». Quand Sarkozy relève l’âge de départ à la retraite, il choisit 62 ans contre ceux qui voulaient d’emblée 65 ans, parce qu’il a le sentiment que 65 ans provoquerait une opposition insurmontable. Quand le gouvernement Mauroy, appuyé par sa majorité, déclenche la guerre scolaire autour de l’enseignement libre, Mitterrand fait reculer son gouvernement parce qu’il pense que les fractures sont trop profondes. On a parfois employé le terme de « Blitzkrieg » pour désigner une stratégie de réforme. Mais le rôle d’un gouvernement n’est pas de déclarer la guerre à tout ou partie de son peuple, sauf contre les voyous, les casseurs ou les terroristes. Son premier devoir est de garantir la paix civile. « Je ne referai pas la France sans les Français », disait de Gaulle en 1958.
Le Point : Craignez-vous, comme le général de Villiers, un risque de guerre civile ?
Henri Guaino : C’est un risque que l’on ne peut plus balayer d’un revers de la main tant la société est fracturée. En 1995, j’avais convaincu Chirac de faire campagne face à Balladur sur la fracture sociale tant elle me paraissait déjà dangereuse et qu’il était urgent de sortir de ce que Philippe Séguin avait appelé un « Munich social ». On sait ce que le gouvernement Juppé en a fait. Depuis, les choses n’ont fait qu’empirer et les fractures se multiplier. Mais le remède n’est pas seulement dans le rétablissement de l’autorité de l’État et de la police. Il est aussi dans la restauration de l’autorité de l’enseignant, dans la reconstruction d’un imaginaire commun, d’une fierté nationale partagée, le retour à une maîtrise des frontières nationales et de l’immigration qui sont les conditions d’une assimilation véritable, à la reconstruction des leviers économiques qui permettront de réduire les fractures sociales et territoriales … En définitive, à la reconstruction de tout ce que nous avons imprudemment déconstruit au cours des dernières décennies et qui permet de maintenir une nation et le sentiment d’une destinée commune. Il y a urgence. Un État fort ayant un prestige et une autorité recouvrée en est le préalable.
Aujourd’hui, l’État n’est pas omnipotent, il est impotent.
Il est partout, mais il n’est fort nulle part.
Le Point : On a quand même beaucoup vu l’État pendant la crise sanitaire (mesures économiques, prise de décision rapide)…
Henri Guaino : Sans discuter ici des mesures elles-mêmes sur lesquelles l’heure des comptes viendra en son temps, on a vu surtout beaucoup de défaillances dans la gestion, en particulier logistique, de la crise, dont les causes sont à la fois anciennes et actuelles. On a vu aussi l’autoritarisme et la politique de la peur pour faire obéir les Français auxquels on a parlé comme à des enfants ou des esclaves. C’est toujours la pire des politiques, ne serait-ce que parce qu’elle fait remonter ce qu’il y a de plus malsain dans la nature humaine, mais aussi parce qu’elle attise des oppositions terribles entre ceux qui sont dominés par leur peur et ceux qui ne veulent se laisser dominer ni par leur propre peur ni par celle des autres.La situation ubuesque où nous plonge cette façon de gouverner – dont les attestations, la fermeture des petits commerces, l’interdiction de vendre et d’acheter des biens soi-disant non essentiels, et les amendes de 135 euros sont les symboles – nous conduit à l’extrême limite de ce que peuvent supporter l’autorité de l’État et la cohésion de la société.
Le Point : Ces défaillances ne mettent-elles pas surtout en évidence la faillite de l’État jacobin qui n’a jamais été aussi omnipotent, aussi envahissant, aussi bureaucratique ? Heureusement, des collectivités locales qui ont pris le relais et ont été beaucoup plus réactives…
Henri Guaino : Aujourd’hui, l’État n’est pas omnipotent, il est impotent. Il est partout, mais il n’est fort nulle part. La dérive bureaucratique est toujours le signe d’un État faible qui dissimule derrière l’amoncellement des lois, des règlements, des procédures, des bureaux, des guichets la défaillance de la volonté et l’incapacité des gouvernements à prendre leurs responsabilités. On paye entre autres la montée de la responsabilité pénale en lieu et place de la responsabilité politique qui conduit gouvernants et fonctionnaires à ne plus penser qu’à se couvrir du risque pénal qui pèse sur eux quand ils prennent des décisions. C’est une tendance destructrice qu’il faut absolument inverser.
J’entends les critiques virulentes contre l’État soi-disant jacobin. Mais ce n’est pas le principe de l’État jacobin, napoléonien ou gaullien qui est responsable des défaillances : l’État napoléonien gaullien, cela fait des décennies que ceux qui crient le plus fort contre lui aujourd’hui s’acharnent à le démolir. Ils dénoncent l’impuissance qu’ils ont eux-mêmes fabriquée : ils ont ruiné l’État, ils l’ont abaissé, entravé, privé de ses leviers et de ses moyens d’action et maintenant, ils disent « regardez, ça ne marche pas, il faut tout liquider ». Le pire, c’est qu’ils arrivent à rallier tant de gens en quête d’un bouc émissaire qui ne voient pas qu’ils seront les principales victimes de la destruction de l’État parce que, sans lui, il n’y aura plus rien à opposer à toutes les forces qui se coalisent aujourd’hui pour les asservir et parce que, la France étant comme l’histoire l’a faite, l’unité de la nation, la solidarité nationale ne survivront pas à l’effacement d’un État central fort, disposant d’une autorité réelle.
On retrouve tous les porte-parole de ce que de Gaulle appelait les féodalités, économiques, financières, corporatistes, territoriales, qui se vivent comme rivales de l’État, dont la vocation est naturellement de les dominer. Il y a aussi les minorités agissantes, les groupes communautarisés qui forment autant de groupes de pression qui, comme toujours, profitent de la moindre occasion pour attaquer l’État.
Les collectivités ont bien sûr leur rôle à jouer, et surtout les communes, et bien des mesures uniformes qui ont été prises dans la gestion de la crise sanitaire étaient à la fois absurdes et incompréhensibles. Mais il ne faut pas confondre ce qui relève du principe de l’État central unitaire et ce qui relève de la responsabilité de ceux qui gouvernent.
Le Point : Mais un pays plus décentralisé comme l’Allemagne a mieux géré la crise.
Henri Guaino : Mais je n’ai pas vu que des pays aussi peu centralisés que les États-Unis, le Brésil, l’Espagne, l’Italie, la Belgique aient tellement bien réussi. Et les pays asiatiques, si souvent cités en exemple, ne sont pas des modèles de décentralisation. En fait, il n’y a aucune corrélation entre le degré de décentralisation de l’État et les résultats sanitaires dans la gestion de cette crise. Méfions-nous des fantasmes et ne jetons pas le bébé de la nation avec l’eau du bain. Comme le disait Georges Pompidou : l’Europe des régions, elle a déjà existé, ça s’appelait le Moyen Âge.
Le Point : Cette crise de l’autorité de l’État n’est pas uniquement française… On la constate dans toutes les démocraties.
Henri Guaino : Dans toutes les démocraties occidentales parce que l’on y a commis les mêmes erreurs et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C’est pour cela que les frontières, les États, les politiques industrielles, commerciales vont faire leur grand retour. Pour le meilleur, si on l’organise, pour le pire, si on refuse encore trop longtemps cette évidence et que l’on attend que les colères populaires balaient tout.
Le Point : Les combats, notamment contre les GAFA, ne sont-ils pas à mener à une autre échelle : l’Europe ? N’est-ce pas le salut des États ?
Henri Guaino : Si l’Europe, c’est celle des États qui se coalisent pour défendre l’indépendance de l’Europe comme le souhaitait de Gaulle, vous avez raison. Si vous voulez parler de la chimère de la souveraineté européenne qui ferait de l’État français l’équivalent de celui du Texas, alors quelque chose dans l’évolution actuelle du monde et des aspirations des peuples vous a échappé. Nous ne sommes pas maîtres de l’ADN des nations.
Le Point : Comment jugez-vous, à la fin de sa troisième année, Emmanuel Macron comme chef de l’État ? On peut dire qu’il a réinstauré de la verticalité …
Henri Guaino : Le diagnostic sur la nécessité de la verticalité était pertinent. La mise en œuvre beaucoup moins.
Le Point : Existe-t-il encore des hommes d’État ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un bon homme d’État ?
Henri Guaino : Le contraire d’un politicien. On a beaucoup de politiciens et pas beaucoup d’hommes d’État.
Le Point : Avec ce constat ne faut-il pas enterrer la V ème République qui correspondait à une époque et surtout à un « Grand Homme » ? Ne faut-il pas en finir avec notre vieux fond monarchique ?
Henri Guaino : Souvenez-vous la prophétie de De Gaulle : « La Russie boira le communisme comme un buvard. » Même le communisme n’a pas réussi à changer la Russie. Nous ne sommes pas maîtres de l’ADN des nations. Au risque de choquer, la France est un vieux pays monarchique quand l’Angleterre, par exemple, est un vieux pays aristocratique. Je crois profondément que l’unité française a besoin d’être incarnée. À chaque fois dans l’histoire que nous avons essayé autre chose, cela a fini en catastrophe.
Mais le monarque républicain n’est pas celui qui dissout sa fonction dans son moi, c’est celui qui dissout son moi dans sa fonction.
Comment croire que la France ne peut pas engendrer des hommes et des femmes au moins capables de ça ? La Vème République a été abîmée par le quinquennat, la judiciarisation, par la supériorité du droit européen et des traités internationaux sur la loi nationale… Le droit ne se fait plus au Parlement, mais dans ce que l’on appelle le dialogue des juridictions. C’est tout cela qu’il faut remettre sur la table au lieu de fantasmer sur une VI ème République qui, au bout du compte, nous renverrait au régime d’assemblée et au gouvernement des juges, à moins que ce ne soit à celui des conventions citoyennes tirées au sort.
Alors, l’avenir de la nation deviendrait encore plus sombre.
Propos recueillis par Florent Barraco pour Le Point.


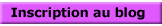

Suivre @ChrisBalboa78
