
Les deux mandats de Macron auront fait des dégâts incommensurables dans l’économie française.
Macron aura bradé l’industrie française en vendant à l’étranger, de façon compulsive, des entreprises françaises dont certaines produisaient des équipements stratégiques.
On se souvient tous de la vente d’Alstom à General Electric et notamment celle des turbines Arabelle utilisées dans nos centrales nucléaires. Turbines que Macron a dû racheter, quelques années plus tard, plus chères qu’il ne les avait vendues !
Mais, le pire est le mal qu’a fait Macron à notre filière nucléaire !
En fermant Fessenheim, en mettant fin au projet d’avenir Astrid, en décidant de fermer 12 centrales nucléaires … puis de finalement les garder !
Macron se laisse imposer par Bruxelles une politique énergétique suicidaire en promouvant des énergies renouvelables dont l’intermittence condamne l’efficacité.
Un nouveau plan de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui va couvrir la France d’éoliennes, est en gestation. Le gouvernement n’ayant pas de majorité à l’Assemblée, Bayrou projette de le mettre en place par un simple décret alors qu’il porte sur un budget pharaonique de 100 milliards d’euros. Le plan est dénoncé par de nombreux spécialistes comme par exemple Fabien Bouglé.
Voici un article de l’IREF qui reprend l’avis très négatif de l’Académie des Sciences sur le funeste projet PPE3 du gouvernement :
Le très sévère avis de l’Académie des Sciences sur la programmation de l’énergie prévue par le gouvernement
Dans sa programmation pluriannuelle de l’énergie, le Gouvernement prévoit d’augmenter la production électrique de manière très coûteuse et probablement déraisonnable. Il se refuse à soumettre cette programmation au Parlement, ne serait-ce que pour avis. L’Académie des sciences s’est saisie du projet et a rendu son avis, plus que réservé, que Pascal Richet, physicien émérite de l’Institut de Physique du Globe vous présente ci-après avant de vous en proposer la lecture.
Selon le code de l’énergie, une loi doit déterminer tous les cinq ans les objectifs de la France en matière de réductions de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, de croissance de la production et du stockage des énergies renouvelables, de diversification des sources de production d’électricité, de rénovation énergétique des bâtiments, et d’autonomie énergétique en Outre-mer. Le texte de cette prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie a fait l’objet de consultations. En dépit de sa nature très technique, son texte n’a pas été soumis en amont à l’Académie des sciences. Celle-ci vient cependant d’émettre un bref avis critique dont l’intérêt justifie une vaste diffusion.
Le point le plus important est l’absurdité de vouloir accroître la part de la production intermittente éolienne et photovoltaïque dans une électricité qui est déjà l’une des plus largement décarbonée au monde grâce à l’hydraulique et au nucléaire. C’est en effet la meilleure façon de déséquilibrer le marché et de renchérir le coût d’exploitation des centrales actuelles au prix de lourds investissements qui mobilisent des ressources matérielles considérables et sont eux-mêmes sources d’imposantes dépenses énergétiques.
Indépendamment des incohérences et vœux pieux également relevés par les Académiciens, les contradictions de fond de ce projet découlent en réalité des buts qui ont lui ont été fixés au départ. Le principal en est la diminution, à défaut de son abandon, de la production nucléaire à laquelle même les Japonais reviennent. Comment cette idéologie peut-elle néanmoins continuer à inspirer la politique énergétique de la France alors qu’elle est défendue par des mouvements dont le poids électoral est devenu marginal ? On n’ose pas imaginer que le capitalisme de connivence puisse être maintenant à la manœuvre …
Je vous invite à lire cet avis ci-après, rendu public le 8 avril 2025.
Pascal Richet
Le texte de la programmation pluriannuelle de l’Énergie (PPE), qui fixe les objectifs de la politique énergétique nationale à l’horizon 2035, vient d’être rendu public (1). Ce document se donne notamment l’ambition de transformer notre système énergétique pour réduire sa dépendance vis-à-vis des ressources carbonées fossiles tout en garantissant la sécurité d’approvisionnement. Il s’agit d’une version révisée, faisant suite à une première version soumise à la consultation publique organisée à la fin de l’année 2024 et à laquelle l’Académie avait souhaité apporter sa contribution (2). Après une analyse rigoureuse de la nouvelle version de ce texte, l’Académie des sciences propose ici son avis, assorti de recommandations.
Avis de l’Académie des sciences
Il est avant tout regrettable de constater que les rédacteurs du document ont accordé bien peu de considération aux nombreux avis formulés lors de la consultation. En effet, la version révisée reste, pour l’essentiel, identique à la version initiale, à l’exception d’une légère diminution de la puissance solaire 3 et de la puissance d’électrolyse pour la production d’hydrogène vert 4 prévues en 2035. Plus préoccupant encore, le texte s’appuie sur des chiffres incohérents, tout comme sa version précédente, et ce malgré les observations précises formulées par l’Académie des sciences dans son avis de décembre 20245.
Par exemple, en page 11 de cette version révisée de la PPE 36, la consommation d’énergie finale prévue est de 1 243 TWh en 2030 et de 1 100 TWh pour 2035. Or, quelques pages plus loin (page 15, Figure 1), ces valeurs sont respectivement de 1 410 et 1 302 TWh7. Ce manque de rigueur engendre évidemment des incertitudes multiples, notamment lorsque l’on applique des pourcentages à des valeurs aussi différentes. Un exemple illustre cette incohérence : la même Figure 1 attribue une part de 39 % à la consommation électrique en 2035, soit une demande de 508 TWh8, tandis que, en page 86, après analyse des différents scénarios possibles (Figure 24), il est indiqué que : « le scénario AMS9 final devrait se situer entre 580 et 600 TWh de consommation (électrique) intérieure en 2035 »10. Parmi les valeurs de 429, 508 ou 600 TWh, quel est réellement le niveau de consommation visé pour 2035 ?
En conséquence, l’Académie des sciences considère, à nouveau, qu’il est nécessaire de procéder à une vérification et une correction exhaustives de l’ensemble des chiffres fournis par ce document, suivies d’une réécriture garantissant sa cohérence.
Le texte actuel n’est pas à la hauteur des enjeux de l’énergie, d’une importance extrême pour la France et ses citoyens.
Il n’a pas non plus le niveau de rigueur attendu d’une production des services de l’État.
L’Académie des sciences soutient l’ambition affichée d’une production nucléaire substantielle (360-400 TWh), source d’énergie bas-carbone de stock, à la fois massive et pilotable11. Cette ambition a d’ailleurs été validée par le Conseil de Politique Nucléaire du 17 mars. Cependant, il est incompréhensible que les objectifs de production électrique totale ne tiennent pas compte, à travers des scénarios alternatifs, de la réalité suivante : depuis 2017, la consommation électrique diminue globalement, passant de 480 à 449 TWh en 2024, en contradiction avec les prévisions. Ce phénomène, observé non seulement en France mais aussi dans la plupart des pays européens, s’explique par plusieurs facteurs : un prix de l’électricité trop élevé qui incite les ménages à plus de sobriété et les industriels à optimiser l’efficacité énergétique de leurs convertisseurs d’énergie, une désindustrialisation persistante et des freins économiques, scientifiques et technologiques à l’électrification des secteurs à décarboner en priorité (mobilité, chauffage, production d’hydrogène, production de carburants de synthèse et industrie). Ce constat souligne l’importance d’un renforcement de la recherche fondamentale, technologique et industrielle.
Dans ces conditions, une accélération rapide et forte de l’électrification des usages paraît peu probable, bien qu’elle soit souhaitable et essentielle pour réduire notre empreinte carbone. En dépit de cela, le projet de PPE 3 affiche pour 2035 des objectifs de production électrique (presque totalement décarbonée, comme aujourd’hui) de 666-708 TWh, bien au-delà de la consommation actuelle et même supérieure à celle prévue pour 203513. Plus inquiétant encore, cette production repose principalement sur une augmentation massive des énergies solaire et éolienne intermittentes, passant de 73 TWh en 2023 à 254-274 TWh en 2035. Cette évolution entraînerait des surcapacités considérables, coûteuses et inutiles, générant un excédent d’offre par rapport à la demande dépassant les 100 TWh, et surtout un taux excessif de production d’électricité non pilotable proche de 40 %.
En effet, en absence de capacités de stockage d’électricité massives, non disponibles aujourd’hui14 et qui ne le seront pas beaucoup plus dans 10 ans15, cet excès de production intermittente non pilotable, qui bénéficie aujourd’hui d’une priorité sur le réseau, induira: (i) une volatilité accrue des prix de l’électricité, avec des périodes de plus en plus fréquentes de prix très élevés alternant avec des prix négatifs ; (ii) la nécessité, pour assurer l’équilibre offre-demande, d’une modulation excessive de la production nucléaire, entraînant des contraintes sur la gestion du parc électronucléaire16 et un sous-emploi de ce parc17, sous-emploi coûteux économiquement et induisant des risques de dégradation des performances des réacteurs18 ; (iii) des tensions sur les réseaux électriques qu’il faut adapter à cette variabilité de la production, ajoutant des coûts supplémentaires considérables au fonctionnement du système énergétique.
L’Académie des sciences soutient la proposition du Haut-Commissaire à l’Énergie Atomique19 visant à accompagner le texte de la PPE d’une analyse approfondie du coût complet de production du système énergétique français, incluant le scénario proposé ainsi que des scénarios alternatifs, ce qui n’est pas fait aujourd’hui.
Il convient de rappeler qu’atteindre une production électrique totalement décarbonée ne requiert nullement une augmentation massive des énergies éolienne et solaire.
Le bilan électrique 2024 de RTE20 montre en effet clairement que le système électrique français actuel, avec déjà 29 % d’énergies intermittentes et un record d’exportation (89 TWh), émet seulement 21,3 g CO2eq par kWh d’électricité produit, soit l’un des taux les plus bas au monde. En comparaison, le système électrique allemand, avec une part de production éolienne et solaire de 45 % en 2024, affiche une intensité carbone de 350 g CO2eq/kWh.
En conséquence, l’Académie des sciences recommande d’explorer des scénarios alternatifs limitant les surcapacités et s’appuyant sur des hypothèses de consommation plus réalistes.
Une évaluation rigoureuse en termes de faisabilité et de coût, fondée sur une estimation des coûts complets pour le système électrique intégrant notamment ceux des stockages et des réseaux nécessaires, doit être menée. Du côté du nucléaire, ces scénarios doivent maintenir les objectifs de construction de nouveaux réacteurs EPR. Ces objectifs sont pertinents, comme l’a, et depuis longtemps, analysé l’Académie des sciences21, parce qu’il faudra remplacer certains réacteurs anciens, quand d’autres pourront être prolongés davantage, construction et prolongation permettant d’éviter l’effet falaise. C’est la seule voie possible pour maintenir une électricité décarbonée, car il ne peut exister de système électrique sans capacités pilotables tant qu’il n’y a pas de systèmes de stockage abondants, efficaces et bon marché. L’alternative, qui consisterait à recourir massivement aux énergies fossiles pilotables (gaz et charbon), pour assurer l’approvisionnement en électricité quand il n’y a ni vent ni soleil, est exclue en raison de leurs effets délétères sur les émissions de gaz à effet de serre, visibles dans les pays qui pratiquent cette option.
Du côté des énergies renouvelables intermittentes, les objectifs de production doivent être mieux ajustés aux besoins réels22. L’Académie des sciences déconseille un développement précipité et massif des sources d’énergie non pilotables sur la base de prévisions de consommation surestimées. Un déploiement raisonné de ces énergies suppose d’abord la mise en place de conditions essentielles, comme l’a souligné un rapport conjoint de RTE et de l’Agence Internationale de l’Énergie (AEI) en 2021 : (i) la disponibilité de capacités pilotables pour assurer à tout moment une puissance au moins égale à la puissance appelée ; (ii) le renforcement des réseaux électriques ; (iii) la disponibilité de capacités de stockage à toutes les échelles de temps23.
Enfin, compte tenu des incertitudes concernant le rythme d’électrification du système énergétique et donc l’évolution de la consommation électrique, l’Académie des sciences recommande de réfléchir à l’instauration de mécanismes garantissant une meilleure cohérence entre le développement du mix électrique et l’évolution de la demande. La croissance de la production décarbonée doit suivre le même rythme que celui de l’électrification des usages, une approche vertueuse tant sur le plan économique que technique.
Pascal Richet pour l’IREF.
La liste des contributeurs et celle des annexes sont à consulter dans l’article original.


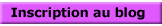
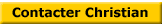
Suivre @ChrisBalboa78

