
« L’existence des exonérations de charges sur les bas salaires crée en réalité un plafond de verre : augmenter de 100 euros un salarié payé entre 1 et 1.3 SMIC coûte 400 à 600 euros à son employeur ».
Lisez et relisez ce sous-titre d’une tribune collective publiée dans Le FigaroVox par des entrepreneurs comme Loïc Le Floch Prigent et des économistes libéraux comme Olivier Babeau. Il résume bien le non-sens de nombreuses mesures fiscales proposées par les petits hommes gris de Bercy, et adoptée par des politiques ignares en économie.
Voici cette tribune que tous les députés, sénateurs et ministres devraient méditer et que chaque Français pourrait trouver intelligente et efficace pour leur pouvoir d’achat .
En résumé, La Tribune propose de réduire la dépense publique de 100 milliards en 5 ans (6 %), une moitié permettant de rembourser la dette et le reste étant rendu aux salariés en pouvoir d’achat.
Fiscalité, dépenses publiques …
Pourquoi les salariés français sont-ils si mal payés ?
Les salariés français coûtent plus cher aux employeurs que dans la plupart des pays européens, mais ils sont parmi les moins bien payés. Pour remédier à ce problème, dix entrepreneurs et économistes dressent un éventail de solutions rapidement applicables.
Un des fondements du modèle de la société libérale est que le travail permet de vivre dignement de ses revenus, que travailler permet d’accéder à la propriété immobilière, d’épargner pour le futur et de s’élever dans la société. Or, en France, l’ascenseur social par le travail est bloqué, comme en témoignent la plupart des indicateurs. Nous possédons par exemple une des plus fortes parts de la population bloquée au salaire minimum, avec plus de 17 % des travailleurs français payés au SMIC en 2023, contre 11 % en 2014, ce qui, d’après Eurostat, nous positionnait en 2018 au 22 e rang européen en la matière (juste avant la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie et la Pologne). L’existence des exonérations de charges sur les bas salaires crée en réalité un plafond de verre : augmenter de 100 euros un salarié payé entre 1 et 1.3 SMIC coûte 400 à 600 euros à son employeur d’après France Stratégie et conduit donc les employeurs à maintenir leurs salariés au SMIC.
Par ailleurs la mobilité sociale entre générations est nettement plus lente que dans les autres pays européens. Il faut six générations pour passer du premier décile de revenu au revenu moyen, contre deux dans les pays scandinaves, et quatre en moyenne dans les pays de l’OCDE ! Les Français qui travaillent ont souvent du mal à boucler les fins de mois, comme en témoigne l’accroissement du nombre de Français à découvert chaque mois (près d’un quart est à découvert dès le 16 du mois). Par ailleurs le revenu de ceux qui travaillent n’est, en relatif, pas suffisamment supérieur à celui de ceux qui vivent de la solidarité nationale pour justifier les contraintes liées à l’exercice d’un emploi. Au sentiment de déclassement s’ajoute ainsi celui de l’injustice, contribuant de fait à la paralysie économique et sociale que notre pays connaît aujourd’hui.
Une des racines de ce problème est que la France est un des pays au monde qui taxe le plus le travail. Notre impôt sur le revenu est certes dans la moyenne de l’OCDE. Il a pour particularité que son taux marginal est très élevé mais que celui-ci s’applique à très peu de contribuables, avec pour conséquence que 10 % des ménages payent 75 % de l’impôt. En revanche nos charges sociales, patronales comme salariales, sont parmi les plus élevées au monde. Et elles affectent quant à elles la quasi-totalité des salariés. La France figure dans le peloton de tête des pays européens où la différence est la plus élevée entre le coût d’un salarié pour une entreprise et ce que celui-ci perçoit effectivement après paiement des charges et de l’impôt. La France est, selon le niveau de salaire, entre le 24 e et le dernier rang européen. Par exemple, pour qu’un salarié français touche un net après impôt de 1.000 euros, son entreprise devra débourser 1.650 euros, contre 1.470 euros pour sa concurrente allemande. Pour qu’un salarié français touche 5.000 euros net, son entreprise devra débourser près de 10.800 euros, soit plus du double, contre 9.400 euros pour une entreprise allemande et 8.500 euros pour une entreprise située aux Pays-Bas. En d’autres termes, les salariés français coûtent cher, mais ils ne le voient pas sur leur compte bancaire !
Les effets pervers de cette surtaxation du travail sont nombreux. Nos entreprises perdent en compétitivité face à la concurrence internationale à cause d’un coût du travail élevé. L’écart trop faible entre la rémunération du travail et les revenus de l’assistance crée des trappes à inactivité car, compte tenu des frais qu’occasionne le fait de travailler, il est souvent peu rentable de reprendre un emploi, surtout si l’on complète les revenus de l’assistance avec un peu de travail au noir. Plus fondamentalement encore, et c’est ce qui mine notre cohésion sociale, les travailleurs salariés sont souvent frustrés et démotivés car ils ont l’impression de « bosser pour les autres ». On ne peut donc que souscrire au diagnostic élaboré par Antoine Foucher dans son ouvrage Sortir du travail qui ne paie plus : on constate en effet que la France a fait le choix politique de davantage taxer le travail que la consommation, avec pour conséquence directe d’un pouvoir d’achat en berne. L’auteur met notamment en valeur le fait qu’une large part de la baisse du pouvoir d’achat est due à une dépense publique excessive.
Les salariés subissent ainsi une double peine – un salaire net fortement réduit par les charges et une inflation sur les prix due au fait que les entreprises sont contraintes d’augmenter le prix des produits et services qu’elles fournissent afin précisément de pouvoir payer les charges.
Quand vous allez au restaurant, vous donnez probablement plus de la moitié du montant payé à l’État ! Sa proposition d’un nouveau contrat social est donc essentielle : il faut redonner 100 milliards d’euros aux 28 millions d’actifs français en baissant le coût du travail. En revanche, le financement qu’il propose est problématique, étant entièrement lié à des hausses de prélèvements sans baisse des dépenses publiques.
Mais comment trouver cet argent ? Le préalable indispensable est qu’il faut baisser la dépense publique d’environ 100 milliards d’euros sur 5 ans, soit 6 % des 1.600 milliards d’euros de dépense actuelle. Il faut avoir le courage politique de demander que la sphère publique se repositionne sur ses missions essentielles et soit gérée avec efficacité, c’est-à-dire en arrêtant de dépenser plus de la moitié de la richesse nationale ! Les pistes d’économies sont nombreuses, notamment : réformer les retraites (plusieurs dizaines de milliards en jeu) ; réduire l’immigration (nous pouvons économiser en 5 ans 7 milliards sur les 41 milliards du coût net de l’immigration) ; simplifier l’administration «administrante» (4 milliards d’économies) ; supprimer les subventions aux énergies renouvelables inefficaces ; mettre fin à la dispersion des moyens et à l’inefficacité de l’action publique qui passent notamment par les nombreuses agences et opérateurs de l’État dont la gestion mérite d’être clairement questionnée (l’exemple récent de l’AFD montre un manque total de contrôle de la dépense) ; lutter contre la fraude sociale ; supprimer un échelon de collectivité …
Si l’on veut ralentir ou stopper la croissance de la dette, la moitié de cette baisse de dépenses doit être affectée à la réduction du déficit, qui pour rappel s’élève à 175 milliards d’euros par an. La deuxième moitié de cette baisse de dépenses publiques permettra de rendre 50 milliards d’euros à ceux qui travaillent.
Il sera alors très clair pour les Français que moins de dépenses publiques conduisent à plus d’argent dans leur portefeuille ! Où trouver les 50 milliards restants ? Pour compléter le financement du nouveau contrat social, la seule solution est de changer l’assiette de financement de notre modèle social, en compensant la baisse des prélèvements sur le travail par une imposition légèrement accrue de la consommation.
D’après le conseil des prélèvements obligatoires (CPO),
la France se situe en effet au 24 e rang de l’UE à 27 en termes de poids de la TVA dans les prélèvements obligatoires et au 19e rang en termes de part dans le PIB,
ce qui démontre l’existence de marges de manœuvre en la matière. Notre taux effectif de TVA, qui se situe aujourd’hui à 9.7 % du PIB (pour 205 milliards d’euros de recettes en 2023), est, selon le CPO, parmi les plus faibles de l’Union européenne. Nous pourrions donc facilement le rehausser à 12.1 % afin de lever les 50 milliards d’euros nécessaires. Cela suppose de réduire le nombre de produits et services soumis aux taux réduits, qui est l’un des plus élevés de l’UE (seulement 65 % de l’assiette est taxée au taux normal contre 71 % en moyenne dans l’UE et 82 % en Allemagne, avec par exemple des taux réduits sur les boissons non alcooliques, les travaux de rénovation, la restauration, le transport de voyageurs, etc.).
Le CPO indique que :
les mesures dérogatoires au taux normal de TVA représentent un manque à gagner d’au moins 47 milliards d’euros (…) [et que] parmi ces mesures, 43 sont considérées par l’administration fiscale comme des dépenses fiscales pour 17 milliards d’euros, (…) c’est-à-dire des taux ayant une visée de soutien sectoriel ou incitative». Il souligne que «les taux réduits de TVA sont des outils inefficaces de politique économique.
Il faudra pour le restant augmenter le taux normal de TVA pour le rapprocher de la moyenne européenne (qui est de 21.5 % contre 20 % en France). Nous notons par ailleurs que, par le passé, les hausses de TVA n’ont été que partiellement reflétées sur les prix de détail, limitant leur effet sur les ménages.
Avec cet impôt en particulier, il est donc possible d’augmenter les ressources de l’État sans pour autant pénaliser significativement les ménages.
À noter également que, s’agissant des actifs qui travaillent, leur gain de salaire net dépassera largement la hausse potentielle du coût de certains produits et services.
Le financement étant assuré, comment concrètement allouer ces 100 milliards de baisses de charges ? Il s’agirait de remplacer la distinction entre charges salariales et patronales par une distinction entre cotisations contributives et non contributives. Les charges contributives, qui représentent 57 % du total des charges salariales et patronales pesant sur les salaires (selon un rapport de la direction générale du Trésor de 2017) peuvent légitimement être assises sur le travail, car elles fonctionnent comme une assurance. Par exemple, les cotisations chômage ou retraite sont très majoritairement contributives car elles assurent contre une perte future de revenus. A contrario, les charges non contributives, qui représentent 43 % du total, fonctionnent comme des impôts déguisés. Puisqu’elles financent notamment la redistribution et des garanties universelles (offertes même sans contribution préalable de ceux qui en bénéficient), elles n’ont aucune raison d’être prélevées uniquement sur les revenus du travail. On parle ici de la santé (280 milliards d’euros en 2022), de la famille (52 milliards), de la pauvreté (comme le RSA, 33 milliards) et du logement (15 milliards). Il faudrait donc supprimer la part non contributive des cotisations famille, pauvreté et logement, pour un total de 100 milliards d’euros. Cela correspondrait à une augmentation à terme du salaire net avant impôt sur le revenu de près de 300 euros par mois pour chaque salarié ! De manière réaliste, il semble possible de rendre 50 milliards de pouvoir d’achat dès la première année, pour rendre 150 euros par mois aux salariés, et d’augmenter chaque année par la suite de 10 milliards, soit 30 euros par mois, jusqu’à atteindre, au bout de cinq ans, les 100 milliards, soit 300 euros par mois.
Au-delà de cette indispensable augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs salariés, ce choix a plusieurs autres vertus. La baisse des charges sur le travail en France rendra la production nationale plus compétitive car les taxes sur la consommation pèseront aussi sur les produits importés. De plus, un message fort et clair sera envoyé : en France, le travail est une valeur, et ceux qui font des efforts en sont récompensés. Cela poussera à une augmentation du taux d’activité et donc de la croissance économique. Enfin, le choix de financer majoritairement cette politique par des économies de dépenses publiques donnera un gage de sérieux budgétaire et contribuera à restaurer la confiance que les prêteurs accordent à la France, contribuant à réduire le coût de la dette et donc à accélérer le cercle vertueux du désendettement. Les Français sont exaspérés par l’impossibilité de s’élever dans la société. Répondons à leur frustration en leur proposant un nouveau contrat social ambitieux et réaliste !
Les signataires :
Arnaud Vaissié, International SOS
Charles Beigbeder, investisseur
Denis Payre, Nature & People First
Olivier Babeau, Institut Sapiens
Stanislas de Bentzmann, Devoteam
Benoît Perrin, Contribuables Associés
Loïc le Floch Prigent
Marc de Basquiat, économiste, président du think tank Aire
Martin Tronquit, Infomineo ; Institut des Français de l’étranger


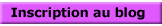
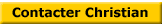
Suivre @ChrisBalboa78

