
Mort il y a soixante-dix ans, George Orwel, l’auteur de 1984 reste un irremplaçable analyste des totalitarismes d’hier, d’aujourd’hui et de demain, qui nous donne les clés pour comprendre l’empire du politiquement correct, mais aussi pour nous en défendre.
C’était l’introduction d’un excellent article de Mathieu Bock-Côté paru dans Valeurs actuelles.
Le nom de l’auteur de 1984 est très souvent cité ces temps-ci, à une époque où la liberté d’expression est de plus en plus menacée. C’est la Loi Avia qui a osé confier à des sociétés étrangères la responsabilité de décider si les propos tenus sur les réseaux sociaux sont corrects ou incorrects et donc s’ils doivent être censurés !
L’article nous rappelle la vision du totalitarisme qu’avait George Orwell et nous montre ainsi les dangers du progressisme tel qu’il se développe en France.
Voici ce texte publié en deux articles successifs :
Première partie
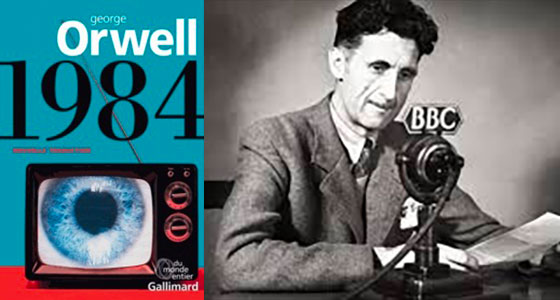
Si les grands titres de presse n’ont pas oublié de marquer, en 2020, les soixante-dix ans de la mort de George Orwell, nom de plume par lequel s’est fait connaître Eric Blair (1903-1950), il n’est pas certain que cette commémoration ait été à la hauteur de son oeuvre, qui a trouvé un nouvel écho en France depuis une vingtaine d’années. Jean-Claude Michéa a joué un grand rôle dans cette renaissance depuis la parution, en 1995, de son livre Orwell, anarchiste tory (Flammarion), où le philosophe français s’appuyait sur lui pour mener une sévère critique de la mystique du progrès et dénoncer la trahison du socialisme originel par la gauche idéologique. Michéa contribuera ainsi à la mise en valeur du concept de common decency, pour rappeler l’importance du commun des mortels et des gens ordinaires dans une époque obsédée par le culte de la « diversité ». Ce concept a pris depuis une grande place dans la vie publique, un peu comme la notion d’hégémonie culturelle empruntée à Antonio Gramsci est aujourd’hui citée par toutes les familles politiques. Citer Orwell, un temps, semblait sophistiqué: c’est devenu presque banal.
Une partie de la jeune gauche s’est aussi emparée d’Orwell pour le transformer en étendard de ses propres luttes décroissantes au point de vouloir en faire sa chasse gardée et d’accuser la « droite » de « le récupérer » dès qu’elle s’en réclame. Qu’Orwell soit une figure du socialisme, c’est l’évidence même : il s’en réclamait ouvertement. Sa vie et son oeuvre, que l’on pense notamment à des livres comme Dans la dèche à Paris et à Londres (Champ libre) et le Quai de Wigan (Champ libre), sont indissociables d’un engagement contre la misère et les injustices qu’il ressentait au fond de son être. Mais le socialisme d’Orwell ne ressemble pas vraiment à la doctrine qu’on a l’habitude de désigner ainsi et était très éloigné des ratiocinations doctrinales du marxisme savant. Il s’agit surtout d’un appel à lutter contre la misère et les inégalités extrêmes, ce qu’il ne croyait pas contradictoire avec une saine défense du patriotisme et des traditions d’un pays. On s’amusera aussi, en lisant ses descriptions moqueuses des intellectuels de gauche, dans lesquels il voyait manifestement les plus mauvais promoteurs de son propre camp, attirant « par une attraction magnétique tous les buveurs-de-jus-defruits, les nudistes, les illuminés en sandales, les pervers sexuels, les quakers, les charlatans homéopathes, les pacifistes et les féministes d’Angleterre ».
Orwell avait le courage physique de ses idées et c’est aussi au nom du socialisme qu’il s’engagera, lors de la guerre d’Espagne, dans le camp républicain. Téméraire, il ira au front, sans verser dans le fanatisme. Il racontera sa guerre dans Hommage à la Catalogne, paru en 1938. Cette expérience le marquera durablement. Il rencontrera sur le terrain le communisme stalinien et plus particulièrement son exceptionnelle capacité à déformer la réalité et à la soumettre intégralement à une entreprise de réécriture idéologique. La question du totalitarisme sera alors au coeur de sa vie et de ses dernières années. On l’associe évidemment à la Ferme des animaux, paru en 1945, mais surtout à 1984, qui paraîtra en 1949, un authentique chef-d’oeuvre qu’une partie de la gauche orwellienne aborde aujourd’hui avec un insensé dédain. C’est pourtant à partir de ce livre qu’il a laissé une empreinte définitive sur l’histoire de la philosophie politique, en décryptant l’expérience du mal radical au coeur du XX ème siècle.
1984 prend la forme d’un roman d’anticipation dans une Angleterre post-révolutionnaire, devenue une société totalitaire. Cela permet à Orwell d’explorer finalement ses effets psychologiques sur ceux qui la subissent, à travers l’histoire de Winston Smith, torturé intérieurement par la possibilité de la dissidence lorsqu’il découvre la nature du système qui pèse sur lui, incarné par la figure de Big Brother.
Car le totalitarisme va bien au-delà de la logique du régime du parti unique. Il se caractérise fondamentalement par le remplacement intégral de la réalité par l’idéologie, qui doit devenir toute-puissante. Il faut apprendre à ne pas « voir ce que l’on voit » et à traduire tous les événements dans la logique du système idéologique officiel. Le totalitarisme, explique Orwell, tord les âmes en obligeant les hommes à accepter que 2 + 2 = 5. Il s’agit de sectionner leur lien avec le réel pour les faire évoluer exclusivement dans le domaine de l’idéologie, c’est-à -dire dans un monde artificiel, en suivant la ligne officielle, malgré ses contorsions qui engendrent une forme de schizophrénie spécifique.
A suivre …
Mathieu Bock-Côté pour Valeurs actuelles.


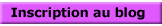

Suivre @ChrisBalboa78
