
La gauche défend toujours les siens !
Peu importe, ce qu’ils ont fait, peu importe ce qu’ils font ! S’ils ont le label de gauche, ils disposent du totem d’immunité. La gauche les soutiendra par principe !
Les exemples pullulent et pourtant la gauche n’apprend jamais rien de ses erreurs !
La gauche a souvent défendu l’indéfendable comme quand elle soutient des délinquants ou des terroristes.
C’est Edwy Plenel qui défendit l’organisation Septembre noir, responsable du massacre de 11 athlètes israéliens aux JO de Munich en 1972.
C’est Mitterrand qui gracia le braqueur de banques Rober Knobelspiess et hébergea l’ayatollah Khomeni.
 Sur le plan politique, la gauche défend une notion de la dictature à géométrie variable.
Sur le plan politique, la gauche défend une notion de la dictature à géométrie variable.
L’URSS était globalement soutenue par la gauche française malgré les cris en provenance du goulag. Mme Danièle Mitterrand et toute la gauche étaient fans de Fidel Castro.
Tout ce beau monde avait applaudi quand les Khmers rouges avaient pris le pouvoir au Cambodge comme le rappelle cet article de Boulevard Voltaire :
Il y a 50 ans, Pol Pot entrait dans Phnom Penh.
La gauche exultait.
Ils avaient soutenu Staline et, pour beaucoup, roulaient encore pour Moscou ; puis ils avaient eu sur leur table de chevet Le Petit Livre rouge de Mao, bible de l’intelligentsia française. Alors, en ce 17 avril 1975, c’était jour de liesse, à Saint-Germain-des-Prés : Phnom Penh venait de tomber aux mains des Khmers rouges. Le génocide qu’ils allaient perpétrer ferait près de deux millions de morts en seulement quatre ans.
Rappelons quelques chiffres, pour mémoire :
- Staline : sans doute 20 millions de morts, dont 6 à cause de la famine en Ukraine, entre 1931 et 1933.
- Mao Tsé-toung : 36 millions de morts par famine, entre 1958 et 1962.
- Pol Pot : entre 1,7 et 2 millions de Cambodgiens exterminés, entre 1975 et 1979, soit le quart de la population du pays.
Des révolutions couvées dans le giron de la France
En principe, on ne parle pas de soi, mais je vais le faire ici. En ce mois d’avril 1975, j’étais une jeune étudiante fraîchement arrivée à Paris. J’y avais, parmi d’autres, des amis cambodgiens que leurs familles avaient envoyés ici poursuivre des études entreprises au lycée français de Phnom-Penh. C’est sur ces familles que s’est abattue en priorité la folie des Khmers rouges et de leur chef, Saloth Sâr, alias Pol Pot, chef du Parti communiste du Kampuchéa.
Bénéficiaire d’une bourse du « colonisateur », Pol Pot était venu à Paris poursuivre des études médiocres à l’école Violet, entre 1949 et 1953. Il est d’ailleurs bon de rappeler ici, comme le faisait Le Parisien en 2015, que :
ces stalino-maoïstes ont, pour la plupart, fait leurs classes à Paris, fascinés par Robespierre et la Commune. Des quelques 250 étudiants cambodgiens qui ont bénéficié d’une bourse pour étudier en France après la Seconde Guerre mondiale, la plupart sont devenus cadres du régime khmer rouge.
Fidèle à ses modèles soviétique et chinois, animé de la même folie paranoïaque, Pol Pot veut abolir la famille, la propriété privée et la religion. Comme Staline et Mao, il va instaurer par la force sa révolution paysanne. Tout ce que la société compte d’intellectuels – professeurs, médecins, ingénieurs, moines bouddhistes… – est immédiatement envoyé aux champs. La plupart des habitants de la capitale mourront d’épuisement en route vers les camps, les autres de faim, de maladie, sous la torture ou au rythme des exécutions sommaires.
À Paris, les nouvelles sont rares. Mes amis sont perdus, tentent d’arracher çà et là des bribes d’information qui contredisent les titres d’une presse enthousiaste. Des mois durant, ils espèreront l’arrivée d’un parent, d’un cousin, d’un frère qui auront pu échapper au massacre en payant au prix fort le passage des frontières. J’apprendrai, des années plus tard, que mon voisin, marchand de journaux si discret, était l’ancien patron de la police de Phnom Penh. Fin lettré, passé par les camps, torturé par le régime qui avait exterminé sa famille, il vivait en retrait et s’appliquait à une discrétion sans faille.
L’incurable cécité idéologique
Dans la chronique qu’elle consacrait sur Europe1, ce 17 avril, à ce sinistre anniversaire, Eugénie Bastié rappelait « le titre glorieux » de Libération, ce jour-là :
Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh ». Le Monde saluait, quant à lui, « un enthousiasme populaire évident », et L’Humanité célébrait « la victoire du peuple cambodgien ».
Pourtant, disait Eugénie Bastié, « on pouvait déjà savoir que derrière les grands idéaux communistes, les miradors et les goulags ne tardaient pas à surgir ». Et Soljenitsyne, invité quelques jours plus tard chez Pivot, « mettait en garde les intellectuels occidentaux contre la tentation de s’aveugler sur les méfaits du communisme ». Qu’à cela ne tienne,: on nous serinerait encore longtemps que tout cela n’est que le dévoiement d’une idéologie incontestable parce que fondamentalement généreuse.
Pas plus que les mues du PC après l’invasion de la Hongrie, en 1956, ou l’entrée des chars dans Prague en 1968, nos intellectuels français ont voulu voir ce qui se tramait au Cambodge. Le veulent-ils, aujourd’hui ? Pas davantage, et l’utopie prométhéenne qui les habitait n’a jamais faibli. « Faire du passé table rase », à n’importe quel prix, est un mot d’ordre qui connaît un regain de vigueur wokiste sur les bancs de l’Assemblée. La leçon n’a jamais été apprise, encore moins retenue. C’est ainsi qu’en 1979, l’année même où la dictature cambodgienne était renversée, une autre révolution avait lieu, à Téhéran cette fois, non pas menée par les communistes mais par les islamistes. Depuis le 10 octobre 1978, jour de son arrivée à Paris, les mêmes – les Sartre, Foucault, Beauvoir et consorts – se précipitaient à Neauphle-le-Château pour baiser le turban de l’ayatollah Khomeiny. La gauche antimondialiste et tiers-mondiste n’avait d’yeux que pour les mollahs, Sartre allant jusqu’à déclarer : « Je n’ai pas de religion, mais si je devais en choisir une, ce serait celle de Shariati », faisant référence au philosophe iranien ‘Alî Sharî’atî, décédé en Angleterre en 1977.
Vingt ans plus tard, j’avais fait la connaissance de Habib Sharifi, un Iranien de grande culture, réfugié en France avec sa famille après la chute du chah. Il enseignait la littérature persane à la Sorbonne et travaillait à son premier ouvrage en langue française : Le Soufisme, mystique de l’Orient. La guerre en Tchétchénie faisait alors rage et je n’ai jamais oublié les mots de cet homme, affolé par l’atmosphère qui régnait ici : « Vous ne comprenez rien, vous ne voyez pas, disait-il. Réveillez vous, le danger, c’est l’islam ! »
Rien n’a changé, Mélenchon et ses affidés en apportent la preuve quotidienne : admirateurs de Robespierre, soutiens des révolutions sanguinaires et des dictatures rouges, aujourd’hui bras armé de l’islamisme, la gauche et ses extrêmes n’ont jamais rien regretté ni renié.
Marie Delarue pour Boulevard Voltaire.


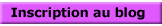
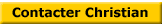
Suivre @ChrisBalboa78
Une réponse à “Ces millions de morts qui ne gênent pas la gauche …”


On ne prête qu’aux riches. Néanmoins, pour une fois, Mitterand n’y est pour rien, et on n’est pas obligé d’oublier les crimes de Lénine.